| La syntaxe de l'inconscient |
| Patrick Lacoste , Science et Avenir Hors-Série Le Rêve Dec. 96 |
| Sommaire |
| La syntaxe de l'inconscient |
| Freud métapsychologue |
| L'inconscient et le cerveau |
| Le déplacement |
| La condensation |
| Les " topiques " freudiennes |
| La mise en images |
| L'élaboration secondaire |
| IMPRESSION |
| Version imprimable (Tout l'article dans une seule page) |
| Science et Avenir Hors-Série Le Rêve |
| Sommaire général |
|
LE " TRAVAIL DU REVE " SELON FREUD |
||
La définition du rêve comme phénomène cérébral n'influe guère sur le sens qu'un rêveur peut donner à son rêve en tant qu'expérience psychique. La psychanalyse commence seulement au point de récit du souvenir de rêve, qui ne concerne ni n'intéresse déjà plus la neurobiologie. Supposera-t-on que l'on peut penser " sans cerveau " ou que la pensée n'est qu'une activité cérébrale ? Tout réductionnisme, qu'il soit descriptif, explicatif ou méthodologique, est invalide.
Il est utile de rappeler que si la neurobiologie du rêve est née des recherches sur le sommeil, la psychanalyse du rêve est née de réflexions sur le symptôme psychique. Freud n'a pas utilisé le rêve pour en faire seulement une " théorie des rêves " mais pour fonder une théorie de l' " appareil psychique " et de son fonctionnement. Aussi la question : " Pourquoi rêve-t-on ? " n'a guère de sens pour la psychanalyse , puisqu'elle ne s'occupe que du sens (jusqu'à l'insensé), précisément, que l'on peut donner à ses rêves, comme à ses symptômes et autres autres formations de l'inconscient. " Pour qui rêve-ton ? ", en revanche, est une question à laquelle la théorie du transfert comme condition d'expérience répond d'emblée en psychanalyse; une condition d'expérience intrasubjective et intersubjective qui ne correspond nullement aux règles d'objectivation requises par l'expérimentation scientifique. La théorie psychanalytique du rêve ne conteste en aucun cas que le rêve puisse avoir des fonctions biologiques, celles-ci ne sont simplement pas son objet - tout au plus peut-elle s'enrichir des données (la théorie du médecin et biochimiste américain Gerald Maurice Edelman, par exemple) qui éclairent ou modélisent les notions de " conscience " et " d'inconscient ". L'aspect empirique de la découverte freudienne n'a évidemment pas bonne presse auprès des hommes de science, qui oublient ainsi la part de hasard, le facteur personnel et circonstanciel, historiquement liés à bien des inventions tout à fait sérieuses. De même, ne fait pas bonne " impression " l'un des derniers postulats de Freud affirmant que, si toute science repose sur des expériences et des observations transmises par l'appareil psychique, le seul fait que la psychanalyse étudie précisément le fonctionnement de cet appareil limite absolument les raisonnements par analogie. On ne saurait oublier non plus que Freud, traitant de la " signification " des rêves, voulait justement introduire un peu plus de rationalité dans un très ancien système de croyances et de superstitions et qu'il n'a cessé, chemin faisant, de multiplier les avertissements contre toute surévaluation du rêve auprès des psychanalystes eux-mêmes... La surévaluation étant au principe de la dogmatisation, on doit remarquer que l'auteur de L'Interprétation des rêves invitait d'emblée, à propos d'une théorie de l'imagination qui lui paraissait juste (celle de Scherner), à se méfier de l'enthousiasme qui semble inhérent aux moindres découvertes à propos du rêve. Mieux encore, il signalait des risques du même ordre dans l'approche purement physiologique, en écrivant déjà: " Il y a aussi un fantastique des cellules cérébrales. " Freud parlera souvent de la " doctrine " du rêve, en particulier à la fin de son oeuvre, pour signaler que les concepts du " travail du rêve " sont les " mots de passe " entre psychanalystes, ce sans quoi la psychanalyse demeure incompréhensible. Les quatre mécanismes originairement décrits (déplacement, condensation, mise en images et élaboration secondaire) constituent une " syntaxe " de l'inconscient à partir du récit de rêve et sont aussi les coordonnées de base d'une disposition d'écoute plus propice à l'interprétation. Les mots de passe ne sont valides qu'à partir des quatre postulats qui suivent. Le rêve n'est pas " fait pour être communiqué " -ce qui souligne les fonctions du souvenir et du récit du rêve. Quand le rêve est " communiqué " par le souvenir et le récit, il n'est en aucun cas interprétable sans les associations d'idées du rêveur lui-même ñ ce qui inscrit d'emblée le rêve dans la parole et le transfert. L'interprétation du rêve n'est en effet pas dissociable de la " règle fondamentale " de l'analyse: dire ce qui vient, comme cela vient, sans omission ni réserve - il en découle une fonction du rêve pour le " mode associatif " requis par l'expérience. Enfin, chaque élément du rêve peut être le point de départ indépendant d'une série d'associations d'idées. Le rêve nous indique une autre scène de la vie psychique, " autre " en ce qu'elle se donne comme coupée de la conscience et de la perception propres aux pensées en état de veille, sans rapport avec l'organisation logique habituelle, comme s'il y avait là une " pure activité " des représentations. Cette pure activité représentative, liée à la force de l'expression figurée, doit justement induire chez l'analyste une méfiance envers la tendance à surestimer le rêve, en rapport avec le principe " d'attention égale ", à savoir la règle technique de ne privilégier aucun matériel associatif. Les concepts désignant le travail du rêve doivent être compris comme descriptifs d'un processus qui est fait de pensées, qui est dans la pensée, mais qui ne " pense pas " par lui-même. Que le " travail du rêve ne pense pas " est une condition de compréhension du niveau inconscient de ces mécanismes, condition qui fait du travail du rêve un modèle d'approche général des formations de l'inconscient: symptômes, oublis, actes manqués, fantasmes. La notion de déplacement est antérieure à la théorisation du rêve ; elle est en fait contemporaine des toutes premières approches de la psychologie des névroses. Cette notion est essentielle pour comprendre la particularité " psychique " du symptôme : ce dernier n'est le plus souvent pas " en face " de l'origine de la souffrance, ni en lien direct avec ses causes - à la différence de la plupart des symptômes " corporels ". Cette notion est apparue devant la nécessité clinique de prendre en compte une certaine dissociation entre les facteurs dits " quantitatifs ", les affects, et les facteurs dits " qualitatifs ", les représentations psychiques. Dans la clinique la plus courante, on comprendra par exemple la constitution d'une phobie comme le résultat d'un déplacement de l'angoisse intérieure (d'autant plus pénible à vivre qu'on ne saurait la rapporter à rien) sur un " objet " du monde extérieur (ainsi, les instruments tranchants ou tel petit animal) ou sur une situation objectivable (ainsi, un espace clos ou un espace trop ouvert), qui permet de " qualifier " et de circonscrire l'angoisse à la situation ou d'en rapporter (faussement) le déclenchement à l'apparition de l'objet. La condensation n'est pas moins a prendre en considération dans l'approche de certains symptômes. Le couteau qui déclenche une réaction phobique peut ainsi condenser les significations de pénétration, de meurtre, de castration: certains organes du corps, ou les mots qui les désignent, peuvent condenser plusieurs significations (la tête, notamment). Qu'un " coup au coeur " ne puisse se manifester que par une sensation d'arythmie cardiaque, cela peut illustrer schématiquement l'intervention combinée de la condensation et du déplacement dans la manifestation du symptôme. La condensation présente aussi le paradoxe d'apparaître, d'un côté, comme un produit de la censure et, de l'autre, comme une " ruse " permettant de ne pas y être soumis. Seul importe le déploiement associatif du point nodal - image composite ou néologisme. Roman Jakobson a su établir un parallèle linguistique entre les mécanismes inconscients, déplacement et condensation, et les figures réthoriques de la métonymie et de la métaphore. Jacques Lacan a " importé " ce parallèle en donnant un véritable statut psychanalytique à la métaphore (condensation) et à la métonymie (déplacement). La dynamique du transfert et la question des affects, comme la notion de " conflit psychique ", interdisent d'enfermer la psychanalyse dans une pratique strictement linguistique - qui permettrait de fuir aisément le débat avec la neurobiologie. Cela ne signifie pas que l'usage de la parole, de même que l'usage inscrit de tout temps dans le langage, soient des instruments accessoires du psychisme humain. En fait, c'est le développement des sciences cognitives - ainsi que le démontre Daniel Widlöcher - qui pourrait servir d'intermédiaire nécessaire dans le débat. Condensation et déplacement s'exercent sur le fond commun d'une symbolique des matériaux représentatifs que le langage exploite régulièrement, et dont l'imagerie du rêve produit des illustrations variables et singulières. La réflexion freudienne traite aussi bien de " l'image acoustique " que du caractère " visuel " de l'image, selon un postulat apparemment discutable mais totalement nécessaire à sa visée: nous appellerons " image " tout ce qui " se comporte comme une image ". Ce comportement d'images appelle une " décondensation " par les moyens de la parole associative, et c'est le point de départ d'autres déplacements. Freud a fait l'hypothèse que la dominance visuelle des souvenirs d'enfance se retrouvait dans le primat visuel du rêve, comme si la scène infantile, ne trouvant pas à se rejouer, se transposait dans l'actuel de la scène du rêve. La spécificité du caractère " visuel " n'est pas assimilable au " visible ", elle doit une part de son intensité à la curiosité sexuelle infantile. La question de l'interprétation sexuelle du désir du rêve - qui suppose une définition extensive du " sexuel " n'est bien sûr pas discutable dans les termes de la neurobiologie qui cherche à s'opposer à la psychanalyse, alors qu'elle l'est encore dans les termes de la " biologie des passions ". En somme, l'interprétation freudienne du rêve cherche l'accès à la falsification des souvenirs et aux fonctions subjectives de la mémoire. Les mots de passe se complètent d'ailleurs par l'élaboration secondaire qui souligne l'inscription, la scénarisation du rêve dans le cours des pensées, dans l'histoire du sujet comme dans celle des tribulations de son désir inconscient. Pour débattre avec la neurobiologie, les prolongements freudiens de ce mécanisme poseraient d'utiles questions sur la construction même des théories. Freud a en effet saisi l'occasion de traiter sur le même plan, du point de vue de la systématisation interne des pensées, le rêve, le symptôme, le délire et... la théorie. La fonction intellectuelle exige l'unification, la cohérence et l'intelligibilité, et remanie les éléments dont elle s'empare en direction d'un nouveau but. Cette logique de l'élaboration secondaire peut forcer les rapports logiques, les plier à un désir de systématisation. En ce sens, une théorie du rêve peut être enracinée dans un rêve de théorie, mettre intellectuellement en oeuvre des phobies de penser, voire ressembler à un délire cohérent -absolument compréhensible du point de vue du système bien que la logique de compréhension soit fondamentalement forcée, orientée... Cet avatar de l'élaboration secondaire pourrait aussi bien servir à critiquer la théorisation freudienne que d'autres théorisations; une telle approche critique n'en serait pas moins définitivement marquée des principes de l'interprétation psychanalytique. Un rêve très " bref " peut être la source de plusieurs récits et d'associations nombreuses. Le rêve est ressource de la parole et du langage en psychanalyse; comme le travail d'interprétation, il ne connaît pas de " dernier mot ". Le rappel (trop) succinct des premières définitions freudiennes du travail du rêve ne saurait suffire à indiquer la technique et le rôle de l'interprétation dans le travail d'analyse - qui n'accorde pas à tous les rêves le même intérêt. Le travail du rêve n'est qu'un modèle inaugural (plutôt exigeant et non systématiquement applicable) de l'approche des formations de l'inconscient. Ce modèle prend place parmi d'autres figures qui illustrent le double déterminisme, naturel et culturel, du psychisme humain - ainsi que le rappelle André Green. La spécificité de la psychanalyse ne trouve son compte qu'à traiter le rêve comme une invention qui ne crée rien, mais une invention que tout appareil psychique peut considérer comme une découverte et transformer en création originale... Toute production de l'esprit, et la théorie en est une, peut faire écran - surface de projection ou de recouvrement - à la vérité psychique singulière des désirs refoulés, une vérité qui se cherche mais ne se révèle pas. Ni la science ni la connaissance n'ont de réel avantage à prétendre détenir le dernier mot; prétention qui serait, en leur sein, rêve masqué de croyance, grand avenir de petites illusions. Pour en savoir plus Lire (chronologiquement)
|
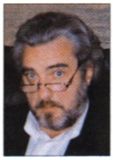
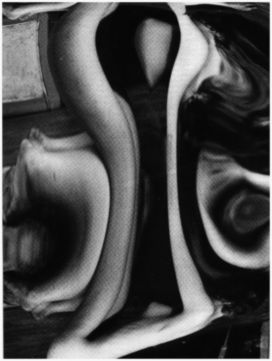 Les
nombreuses résistances au dialogue entre psychanalyse et
neurobiologie ne doivent pas faire oublier deux questions. La première
est dans la surestimation des apports de la neurobiologie quant
à l'éclairage du " fait psychologique ",
une telle amplification justifie encore aujourd'hui la prudence
inaugurale de Sigmund Freud. La deuxième question reviendrait
à craindre que la controverse sur le rêve ne soit qu'un
masque supplémentaire du vieux débat entre l'origine
organique et l'origine psychique des troubles mentaux; ceci jusqu'à
la prise en considération des effets thérapeutiques
de la chimie, où la neurobiologie, si elle est devenue performante
quant au descriptif et à l'exploration des effets, n'est
pas définitivement convaincante au niveau des causes...
Les
nombreuses résistances au dialogue entre psychanalyse et
neurobiologie ne doivent pas faire oublier deux questions. La première
est dans la surestimation des apports de la neurobiologie quant
à l'éclairage du " fait psychologique ",
une telle amplification justifie encore aujourd'hui la prudence
inaugurale de Sigmund Freud. La deuxième question reviendrait
à craindre que la controverse sur le rêve ne soit qu'un
masque supplémentaire du vieux débat entre l'origine
organique et l'origine psychique des troubles mentaux; ceci jusqu'à
la prise en considération des effets thérapeutiques
de la chimie, où la neurobiologie, si elle est devenue performante
quant au descriptif et à l'exploration des effets, n'est
pas définitivement convaincante au niveau des causes...